L’un est un éminent professeur au Collège de France, où il dirige la chaire «Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines». L’autre est un incontournable enseignant en sciences politiques qui vit en Israël depuis cinquante ans et se définit comme un citoyen franco-israélien de gauche. Dans Une étrange défaite (la Découverte), Didier Fassin, dont les travaux portent sur la question de «l’inégalité des vies», revient sur le soutien «passif et actif» des pays occidentaux à la destruction de Gaza et au massacre de sa population.
Sa vision de l’intensification du conflit au Proche-Orient depuis le 7 Octobre diverge parfois profondément de celle de son confrère Denis Charbit qui publie Israël : l’impossible Etat normal (Calmann-Lévy). Pour ce dernier, professeur de sciences politiques à The Open University of Israël, cette guerre, qui a commencé bien avant l’attaque sanglante du Hamas en Israël il y a un an, a annihilé toute notion d’universel chez les Israéliens comme chez les Palestiniens. Guerre des récits, qualification de génocide, antisémitisme… Entre les deux chercheurs, les points d’entente sont rares, mais la volonté de dialogue bien présente.
Quelles leçons tirez-vous de l’année qui vient de s’écouler ?
Denis Charbit : Ce fut l’année terrible. Israéliens et Palestiniens sont sous la coupe des leaders les plus funestes qu’ils ont connus depuis un siècle. On parle du «jour d’après», mais si Nétanyahou est réélu aux prochaines élections, il n’y en aura pas. Pas plus de «jour d’après», au demeurant, si le Hamas se maintient, si exsangue soit-il. Le 7 Octobre a fait ressurgir la question palestinienne en Israël non à travers l’opération elle-même, le nombre de morts pourtant sans précédent, ou encore la prise d’otages, mais à travers les modalités du massacre, la jouissance de donner la mort et de la filmer. La manière dont le Hamas a opéré vise à rendre impossible toute perspective de réconciliation. Afin qu’il n’y ait plus un seul Palestinien qui trouve légitime la présence des Israéliens sur cette terre et pour qu’en Israël, plus aucun Juif ne puisse pardonner et chercher la paix.
Un abri, dans le kibboutz Mefalsim, où des personnes ont été tuées alors qu’elles y cherchaient refuge le 7 Octobre. (Amir Cohen/REUTERS)
Même si la situation était invivable en Palestine, on ne saurait conférer à ce qui s’est passé la dignité d’une «révolte». C’est nier et noyer l’horreur de l’événement. Le Fatah, qui a commis maints attentats, n’aurait jamais entrepris un pareil massacre. Quand António Guterres dit : «It did not happen in a vacuum» [«cela ne s’est pas produit en dehors de tout contexte», ndlr], tout le monde a pensé à la «Nakba» et à l’occupation, faisant passer à la trappe le ressort majeur de cette attaque : l’islamisme.
Didier Fassin : Il y a une triple temporalité de cette année écoulée. La première correspond à une date, le 7 Octobre, qui a profondément traumatisé les Israéliens et une grande partie des Juifs de la diaspora, car c’est l’attaque la plus meurtrière subie par le pays depuis sa naissance et elle a ébranlé la confiance que les habitants avaient dans l’invincibilité de leur armée. La seconde se réfère aux mois qui ont suivi, avec la destruction de Gaza. Elle procède d’une intention proclamée par le gouvernement israélien et ses plus hautes instances militaires de punir non pas simplement le Hamas, mais aussi la nation palestinienne, en éliminant le territoire de la face de la Terre, dans les mots du vice-président de la Knesset. La troisième se rapporte à ce qui s’est passé avant, qu’on remonte à la déclaration Balfour de 1917, à la création d’Israël sous l’égide des Nations unies en 1948, ou encore, ce qui est plus souvent retenu, à la fin de la guerre des Six Jours en 1967.
Dans le quartier d’Al Rimal, dans l’ouest de la ville de Gaza, le 10 octobre 2023. (Loay Ayyoub/Getty Images)
Mon travail a été de relier cette triple temporalité et de voir comment elle a été traitée, parfois malmenée, souvent effacée voire censurée. S’agissant du 7 Octobre, une version la qualifie de pogrom, autrement dit un assassinat de Juifs en tant que tels. C’est celle qui s’est imposée dans la plupart des pays occidentaux, le président français parlant du «plus grand massacre antisémite de notre siècle». L’autre la désigne comme une résistance, la considérant comme une réponse tragique à des décennies d’occupation. Une analyse dénoncée dans ces pays comme apologie du terrorisme. Le choix de l’une ou l’autre de ces versions a des conséquences importantes. S’il s’agit d’un pogrom, c’est un crime contre l’humanité qui évite tout contexte historique et nie toute responsabilité israélienne. S’il s’agit d’un acte de résistance, aussi terrible soit le meurtre de civils, il y a ce que les anthropologues appellent une «situation», qu’il importe de comprendre en vue d’une solution pacifique.
Aujourd’hui, peut-on encore être à la fois pro-israélien et pro-palestinien ?
D.C. : Je peux reprendre à mon compte une partie du propos de Didier Fassin, mais cette lecture reste foncièrement hémiplégique. On peut et on doit accabler Israël, et je le fais, mais il faut se tenir sur une ligne de crête et entendre ce qu’il y a d’audible dans chacune des deux parties. Vous prétendez examiner les thèses de part et d’autre : il n’y a pas une seule thèse côté israélien que vous reprenez à votre compte. Car ce qui préside dans le débat d’idées autour de ce conflit, c’est la logique du prétoire. Notre fonction comme intellectuel n’est pas d’être l’avocat de la défense pour sauver son client devant le tribunal de l’histoire en prenant bien soin de cacher ses fautes.
Je ne suis pas là pour défendre une cause, mais poser à chacune des parties la limite à ne pas franchir. Israël a le droit d’exister, pas celui de coloniser. Les Palestiniens ont le droit à l’autodétermination, pas celui de liquider Israël en paroles et en actes. S’il y a bien une année où il aurait dû être particulièrement compliqué de se déclarer pro-palestinien ou pro-israélien, c’est bien cette année. Concernant le massacre, quelle est la part du libre arbitre et la part du contexte ? Je plaide par principe : 50-50. Sartre explique dans L’existentialisme est un humanisme que même en prison, un détenu peut décider de coopérer avec son geôlier ou de déclencher une mutinerie.
Comme j’accorde plus de poids à la conscience individuelle, la formule devrait être : 49 % de nos actes relèvent du contexte, 51 % à notre responsabilité propre. On n’exonère donc pas le Hamas à cause du contexte, pas plus qu’Israël. Je suis d’accord avec vous quand vous notez que les gouvernements européens ont soutenu Israël pendant la guerre. Mais on ne peut le dire des médias ou des intellectuels. Pour expliquer ce soutien, vous émettez l’hypothèse de la culpabilité des pays occidentaux qui tiennent à se racheter après l’Holocauste. C’est vrai pour l’Allemagne, pas pour les autres Etats. Puis vous avancez une seconde explication : le racisme antimusulman des élites européennes. Or, il me semble que la raison du soutien à Israël tient à la fois à la menace iranienne et au massacre du 7 Octobre.
D.F. : Rappeler l’histoire n’est pas mettre en cause l’existence de l’Etat d’Israël. Evoquer que cette existence est un fait colonial, c’est simplement se souvenir que le colonisateur britannique en est à l’origine, et que la colonisation se poursuit depuis plusieurs décennies. Mais les Etats-Unis ou l’Australie ont aussi une histoire coloniale. Ensuite, expliquer n’est pas justifier. Cette confusion a souvent été utilisée pour délégitimer le travail des sciences sociales. Dans l’Etrange Défaite, quand Marc Bloch explique les raisons de la débâcle française face à l’armée allemande, il ne justifie rien.
Venons-en aux explications du consentement des pays occidentaux à l’écrasement de Gaza. L’invocation de la dette des pays occidentaux à l’égard d’Israël doit être relativisée, car même les Allemands admettaient après la Seconde Guerre mondiale aider Israël pour établir un bastion occidental dans un monde arabe hostile. Cet enjeu géopolitique est essentiel, sans cesse rappelé par Nétanyahou. Les dimensions économique, avec la création d’un grand marché au Moyen-Orient, et militaire, avec la livraison d’armements, sont également importantes. Mais on ne peut nier l’exacerbation récente d’un racisme antiarabe et antimusulman documenté par de nombreuses enquêtes internationales. Or, les Palestiniens sont arabes, majoritairement musulmans et, de surcroît, insidieusement associés au terrorisme.
Selon vous, est-il pertinent de parler d’un génocide des Palestiniens à Gaza ?
D.F. : Concernant la qualification de génocide, des arguments solides ont été apportés par l’Afrique du Sud, jugés plausibles par la Cour internationale de justice. Il s’agit de l’intention, exprimée par les plus hauts dignitaires israéliens, de faire disparaître Gaza et ses habitants, et de sa concrétisation à travers les bombardements des populations civiles, l’asphyxie du territoire par un siège total, le blocus de l’aide internationale, les meurtres de travailleurs humanitaires. Mais l’officialisation de cette qualification n’interviendra éventuellement qu’au terme d’un long processus judiciaire dans lequel les rapports de force entre pays pourront s’avérer plus déterminants que le droit international. La possibilité d’un génocide commis par l’Etat hébreu créé après la Shoah est une question éminemment sensible.
D.C. : Il y a une réalité indéniable : le nombre de civils tués par les frappes aériennes d’Israël. Je ne crois nullement à l’intention génocidaire d’Israël au sens d’élimination systématique. Deux facteurs expliquent cette hécatombe : les mécanismes qui permettent à une population civile d’être épargnée n’ont pu jouer à Gaza : pas d’abri souterrain pour les protéger et pas de pays voisin pour s’y réfugier. La rage consécutive au 7 Octobre et la détermination à éradiquer le Hamas ont conduit le gouvernement et nombre d’Israéliens à s’affranchir des règles qui encadrent un conflit. Il n’y a pas eu de volonté préalable, mais on s’est accommodé d’un bilan meurtrier si élevé. Comme aurait dit le philosophe israélien Yeshayahou Leibowitz (1903-1994), disparu il y a trente ans : «Même si cela peut être justifié, cela reste maudit.» Trop de mes concitoyens penchent du côté de la justification. Je fais partie de ceux, minoritaires, qui jugent la riposte maudite.
La question de l’égalité des vies, sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, Didier Fassin, est au cœur des tensions…
D.F. : Lors des deux précédentes guerres à Gaza, en 2009 et en 2014, il y a eu 250 fois plus de civils tués du côté palestinien que du côté israélien. Dans le conflit en cours, on parle de plus de 40 000 morts, nombre sous-estimé, car il ne prend en compte que les corps retrouvés. En proportion de la population, c’est l’équivalent de 1,3 million de morts en France. Mais l’inégalité des vies ne se résume pas à une comptabilité des morts. Elle tient à la qualité des existences vécues, d’un côté, par les Israéliens libres de se déplacer, d’étudier, de travailler, d’être des sujets de droit, et de l’autre, les Palestiniens sous la menace permanente de destruction de leurs champs, d’attaques de colons, de tirs de soldats, d’emprisonnements illimités sans chef d’accusation.
Depuis le 7 Octobre, le traitement médiatique de ces vies a été largement asymétrique. Des Israéliens, on a décrit le quotidien, les inquiétudes, les colères. On a moins parlé des exactions de leurs soldats et des tortures infligées à leurs prisonniers. Des Palestiniens, on n’a guère entendu la voix pour savoir les souffrances des mères dénutries incapables d’allaiter leurs nouveaux-nés et les traumatismes des enfants orphelins et blessés. Après la libération de quatre otages israéliens par l’armée le 8 juin dernier, les grands médias audiovisuels ont rendu compte de cette opération réussie et du soulagement des familles, mais se sont contentés de mentionner en fin de reportage les 274 morts et plus de 700 blessés parmi les civils palestiniens lors de l’intervention. Un autre récit présente cette opération comme le «massacre de Nuseirat».
D.C. : J’envie les Européens pour qui une vie en vaut une autre. Mais ne nous leurrons pas. La logique de guerre au Moyen-Orient anesthésie la notion d’universel et déshumanise. Je ne peux pas penser une seconde que pour un Palestinien, la vie d’un Israélien est égale à la sienne. Et vice versa. Les 1 200 morts israéliens m’ont arraché des larmes que je n’ai pas versées pour les civils parmi les 40 000 morts palestiniens. Je le déplore, bien entendu.
La proximité géographique, ethnique, religieuse, linguistique, familiale joue dans l’émotion que nous ressentons face à la mort de quelqu’un. Mais si l’on s’est plus apitoyé en Europe sur les victimes israéliennes que sur les victimes palestiniennes autrement plus nombreuses, ce n’est pas à cause de la nationalité, de la religion ou de la condition politique de la victime, mais à cause des conditions dans lesquelles la mort a été infligée.
C’est-à-dire ?
D.C. : Larguer une bombe qui fait des centaines de morts et massacrer un par un des festivaliers de Supernova ou des habitants des kibboutz n’est pas perçu de la même manière. Pourquoi ? Sans doute parce que nous sommes plus rebutés par la mort perpétrée consciemment que par la mort qui fauche aveuglément. Le sentiment qui domine en Israël et en diaspora, c’est que cela fait bien longtemps que les victimes palestiniennes ont recouvert par leur nombre les atrocités commises le 7 Octobre sur les Israéliens.
L’émotion en Israël est également conditionnée par l’histoire longue : non, tout ne commence pas pour les Israéliens le 7 Octobre. Cette date s’inscrit dans une autre temporalité : la longue série du refus arabe et palestinien d’Israël : le refus du plan de partage en 1947 ; puis l’échec, en 2000, du sommet de Camp David ; enfin, le retrait du Sud-Liban en 2000 et le désengagement de la bande de Gaza en 2005.
La leçon qu’en ont tirée la plupart de mes concitoyens, c’est que lorsque Israël se retire d’un territoire, il y perd en sécurité. Comment voulez-vous plaider, comme je le fais avec mon bâton de pèlerin, pour le retrait de la Cisjordanie ? Mais attention, je n’ai pas une lecture hémiplégique du conflit : il y a eu la Nakba en 1948 et il y a l’occupation depuis 1967. Trop de mes concitoyens refusent de comprendre que notre droit imprescriptible à l’existence nationale et étatique ne peut moralement se réaliser en persistant à dénier le droit à l’existence nationale et étatique des Palestiniens.
D.F. : Affirmer que la mort fauche aveuglément à Gaza, quand un ministre dit trouver moral d’affamer les deux millions d’habitants, quand on bombarde des écoles où l’on a demandé aux déplacés de trouver protection, quand on tire sur des personnes venues se ravitailler, quand on tue dans des camps de torture, c’est ajouter à l’injustice de l’inégalité des vies l’injustice de sa justification.
Dans ce contexte, prendre parti pour la souffrance des Palestiniens et se faire la critique de la politique du gouvernement israélien a pu être taxé d’antisémitisme…
D.F. : Le paradoxe est que la critique d’un gouvernement dominé par l’extrême droite, pratiquant le suprémacisme religieux, irrespectueux du droit international, accusé de génocide, ait pu être assimilée, en démocratie, à de l’antisémitisme. Cette accusation a été instrumentalisée après le 7 Octobre dans la plupart des pays occidentaux pour réduire au silence les protestations contre les massacres commis à Gaza et les demandes d’un cessez-le-feu.
Il faudrait revenir à la lettre de la définition de l’Alliance pour la mémoire de l’Holocauste reconnue en 2016 par 31 Etats, dont la France, l’Allemagne, les Etats-Unis et Israël, qui affirme que critiquer Israël comme on critiquerait tout autre Etat ne peut pas être considéré comme de l’antisémitisme. Sans compter l’explication de texte fournie par les 350 spécialistes des études juives du monde entier dans la Déclaration de Jérusalem en 2020, qui précise que s’opposer au sionisme en tant que forme de nationalisme, ou plaider pour le boycott, le désinvestissement et les sanctions, ne relève pas de l’antisémitisme. Une telle reconnaissance ferait reculer le véritable antisémitisme, lequel doit bien sûr être condamné.
Lors d’une manifestation contre l’antisémitisme organisée par le Crif, à Montpellier, le 27 août 2024. (Pascal Guyot/AFP)
D.C. : Oui, mais vous omettez de dire dans votre livre que l’antisémitisme en France tue. Vous évoquez l’antisémitisme pour dire qu’il est encore largement d’extrême droite, mais surtout pour gloser sur l’instrumentalisation de l’antisémitisme par Israël et par les institutions juives, etc. L’antisémitisme n’est pas qu’un discours, c’est un passage à l’acte, comme on l’a vu récemment avec l’attaque de la synagogue de la Grande-Motte. Quant à l’antisémitisme de militants de l’extrême gauche, vous n’en dites rien. Pourtant, il y a des discours qui ne trompent pas. Mais, en vérité, ce ne sont pas tant les préjugés antisémites qui me préoccupent que la violence antisémite, qui a très fortement augmenté depuis le 7 Octobre.
D.F. : Les enquêtes montrent qu’il y a en France un recul progressif du sentiment antisémite, mais avec une recrudescence lors des guerres contre les Palestiniens. L’antisémitisme est évidemment une réalité, comme le sont d’ailleurs l’islamophobie et le racisme anti-arabe, aujourd’hui plus prévalents dans notre société. Les Français sont quatre fois plus nombreux à dire qu’ils ne se sentiraient pas à l’aise si leur voisin était musulman que s’il était juif.
Rassemblement de soutien aux Palestiniens, place de la Nation à Paris, le 8 septembre 2024. (Fiora Garenzi/Hans Lucas)
Denis Charbit, à quel moment l’antisionisme recoupe-t-il l’antisémitisme ?
D.C. : «Antisémitisme» et «antisionisme» ne doivent pas être confondus. L’accusation d’antisémitisme doit être l’arme du dernier recours. Je suis terrifié de voir le ministre des Affaires étrangères israélien dénoncer Joseph Borrell comme un antisémite. C’est consternant. Mais quiconque se dit antisioniste doit se poser en permanence la question de son lien potentiel à l’antisémitisme. Toute remise en cause de l’existence de l’Etat d’Israël – pas de sa politique – peut converger avec l’antisémitisme, car il n’est pas un seul pays qui colonise, occupe et fait la guerre dont on réclame la disparition, excepté Israël. Cette exception mérite réflexion, tel le slogan «Free Palestine from the river to the sea», qui induit la disparition d’Israël et des Juifs en Israël.
D.F. : Il faut rappeler que ce slogan est présent en 1977 dans la Plateforme du Likoud, parti le plus souvent au pouvoir depuis un demi-siècle, soit onze ans avant sa formulation dans la charte du Hamas. «De la mer au Jourdain, il n’y aura de souveraineté qu’israélienne», proclame le texte. Le Premier ministre l’a rappelé à plusieurs reprises dans les mois qui ont précédé le 7 Octobre, y compris en montrant devant l’Assemblée générale des Nations unies une carte du Moyen-Orient sur laquelle Israël avait absorbé la Cisjordanie et Gaza. La colonisation de la première et la destruction de la seconde indiquent d’ailleurs que, loin d’être menacé dans son existence, l’Etat hébreu œuvre à la disparition de la Palestine.
Comment sortir de cette situation où la perspective d’une solution pacifique semble inconcevable ?
D.C. : Ce n’est pas en invoquant l’exemple de l’Afrique du Sud, comme Didier Fassin le fait dans son livre, que l’on va inciter les gouvernements occidentaux à réviser leurs positions et convaincre les Israéliens qu’ils ont tort de coloniser. C’est en leur disant qu’ils ont les moyens d’imposer à Israël le retrait des colonies et le retour aux frontières de 1967. A tout prendre, je préfère la partition exemplaire qu’ont réalisée Tchèques et Slovaques. Havel n’est pas moins valeureux que Mandela.
Nonobstant leur effroyable condition, ce n’est pas favoriser la réconciliation entre les deux peuples que de dire aux Palestiniens : vous souffrez, donc tout est permis. L’indépendance d’Israël n’est pas négociable, pas plus que celle de n’importe quel Etat de la planète, et c’est vrai aussi de la Palestine. C’est pourquoi notre devoir comme intellectuel n’est pas de délivrer des permis de tuer, mais de donner des «conseils de prudence», comme dit Camus.
D.F. : Des intellectuels délivrant des permis de tuer ont, en effet, été entendus en Israël après le 7 Octobre, et c’est regrettable. Mais le cas de l’Afrique du Sud, où j’ai mené des recherches pendant huit ans, mérite l’intérêt, car il montre les conditions de possibilité d’un chemin vers la paix. En 1994, après un siècle de ségrégation, puis d’apartheid, le pays était au bord de la guerre civile. Et pourtant, une transition démocratique et pacifique a eu lieu.
Trois éléments ont permis cette évolution heureuse : l’existence de mouvements de résistance dans le pays, soutenus par les syndicats et des églises ; la multiplication des pressions internationales, avec la campagne de boycott, désinvestissement et sanctions ; enfin la présence d’un leader visionnaire, Nelson Mandela, et d’un politicien pragmatique, Frederik De Klerk. Aucune de ces conditions n’existe malheureusement aujourd’hui en Palestine

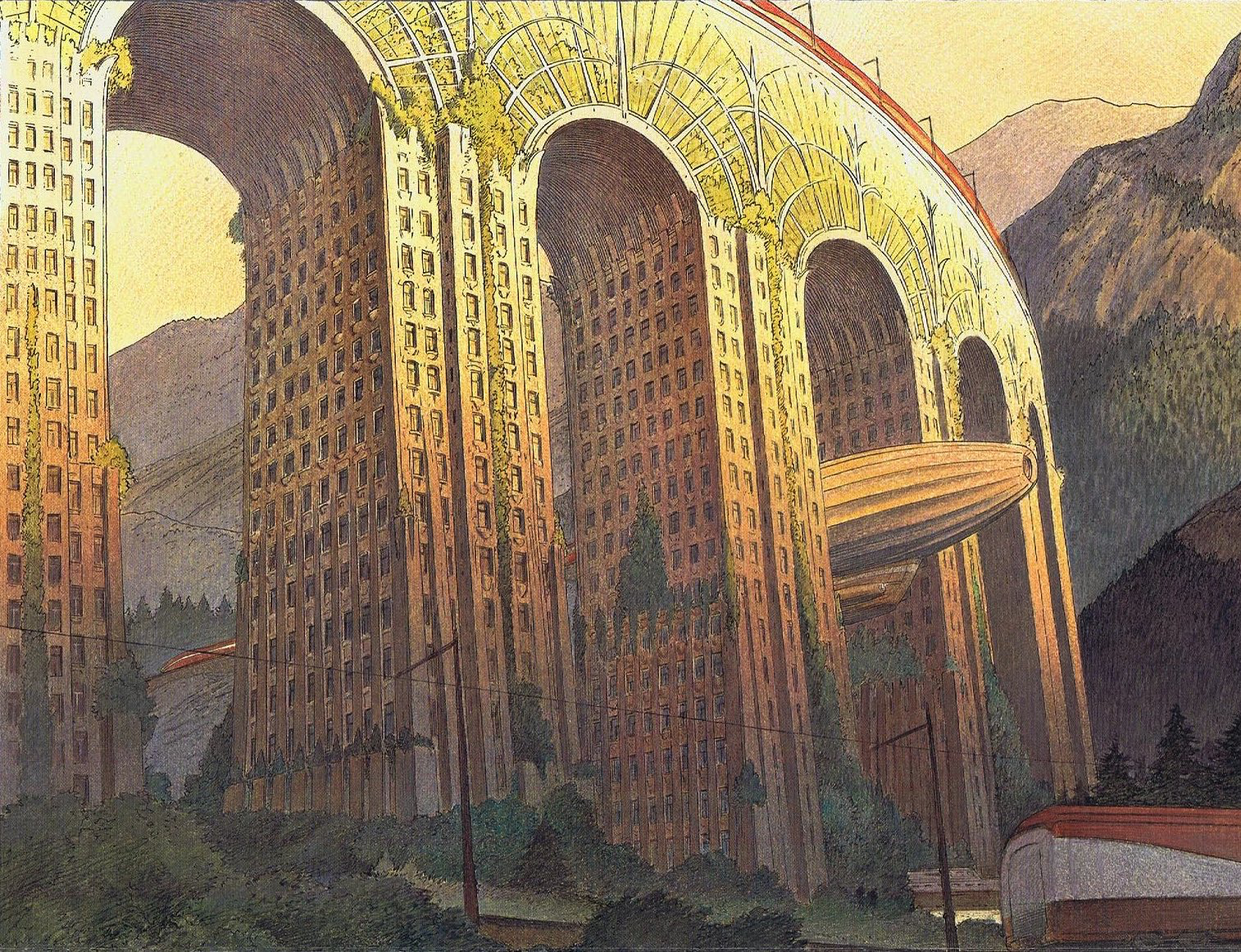
Récemment, Didier Fassin, prof à l'EHESS et au Collège de France, a été lauréat 2024 de la Huxley Memorial Medal du Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland.
En gros pour dire à quel point le discours médiatique et intellectuel sont, sur ce sujet, complétement différents.